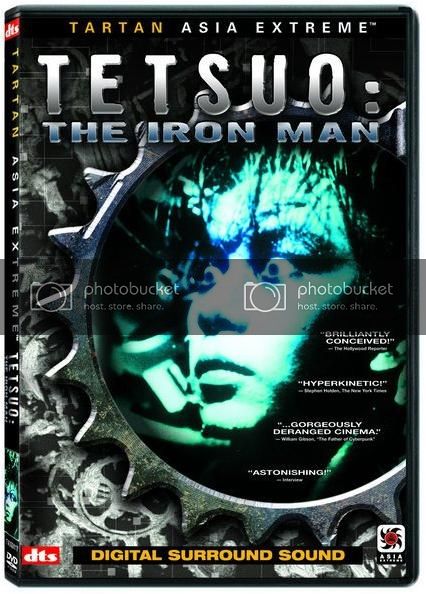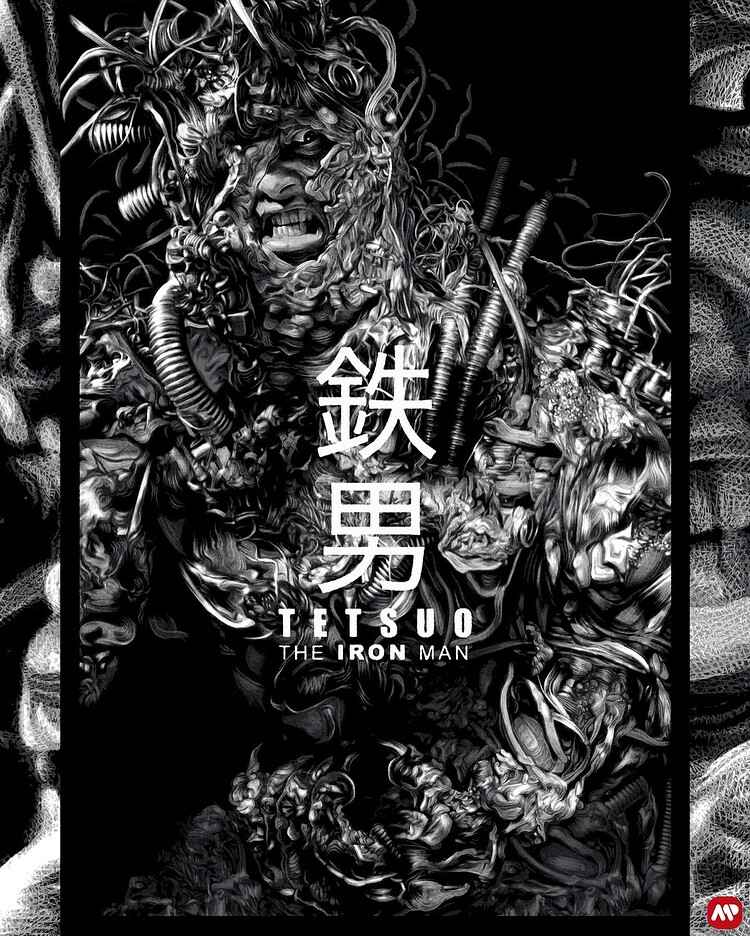Voilà un film très important pour moi.
Je l’ai vu à un moment particulier de ma vie de spectateur de films, c’est un des quelques titres qui ont considérablement boosté mon intérêt pour le cinéma.
Tsukamoto est ce mec étrange, très doux et modeste en interview, qui a su trouver avec trois bouts de ficelles et deux machines à laver en pièces détachées le moyen de déchaîner les possibilités purement cinétiques du genre…
Imprégné des travaux de Scorcese (surtout « Taxi Driver ») mais aussi Cronenberg (difficile de ne pas penser au génial « Videodrome »), Tsukamoto appartient à cette fameuse génération super 8 japonaise, à laquelle appartient aussi Kiyoshi Kurosawa (« Shokuzai », « Real »). Il bricole dès l’adolescence des films étranges qui doivent autant à la culture populaire japonaise qu’aux travaux d’avant-garde d’un Epstein dans les années 20. En parallèle, il travaille également au théâtre et monte une compagnie improbable appelée le « Kaiju Theater », où il importe le genre kaiju eiga sur les planches…!
Cette influence reste prégnante sur « Tetsuo » mais aussi sur quelques travaux antérieurs, malheureusement invisibles du fait de la naïveté d’un Tsukamoto qui n’a pas pris soin d’acquérir les droits de la musique qu’il a utilisé.
Sur « Tetsuo », Tsukamoto n’a pas un rond, et fait quasiment tout : réalisation, décors, scénario, jeu, maquillages, effets spéciaux, montage…Tsukamoto est partout et va même jusqu’à dessiner lui-même les affiches, dans une conception du cinéma artisanale et irrésistiblement sympathique, et en même temps porteuse d’une forte impression d’avoir affaire à un auteur total, comme un auteur de BD qui ferait tout du script au lettrage.
« Tetsuo » est un renvoi évident au mythique enfant-mutant du fameux « Akira » de Katsuhiro Otomo ; Tsukamoto partage avec son compatriote l’obsession de l’environnement urbain vu comme un champ de ruines impactant jusqu’à la biologie de ses occupants. Le scénario de « Tetsuo » est famélique (le film narre l’histoire d’un salary-man japonais anonyme et terne qui mute en un monstre d’acier suite à une collision en voiture), mais thématiquement vertigineux. Développant une étonnante relation amour / haine à la capitale japonaise, comme dans ses autres grands films « Tokyo Fist » (« Requiem for a Dream » et « Fight Club », qui l’ont pompé, en un seul film) et « Bullet Ballet », peut-être le plus beau Tsukamoto, le japonais décrit un enfer urbain et cinématique total, d’une puissance étourdissante, avec des moyens ridicules.
Tsukamoto a réussi ce tour de force en réfléchissant de manière approfondie sur une esthétique de la décharge et de l’hybridation, accouchant de merveilles au niveau des maquillages et des costumes, « Tetsuo » demeurant quasiment la seule et en tout cas la plus éclatante représentation à l’écran du feeling cyberpunk. Il injecte dans son étrange narration (plus une accumulation de scènes hallucinées décousues que véritable intrigue qui se déploie) une réflexion sur la douleur physique et la sexualité qui semble d’un point de vue occidental éminemment japonaise (la douleur comme un pis-aller pour se sentir vivant, c’est cet aspect qu’un « Fight Club » emprunte à Tsukamoto justement). Ou comment la technique affecte les humains directement, impactant leur chair comme chez Ballard ou Burroughs.
C’est du point de vue formel que Tsukamoto épate principalement, portant le montage à un point d’ébullition jamais vu auparavant, que les maëstros du video-clip limités dans leurs effets par la durée qu’ils travaillent ne peuvent que rêver effleurer. Travaillant la stroboscopie comme epu de cinéaste avant lui, réinventant carrément le principe de la stop motion poussée dans ses retranchements, le cinéaste japonais parvient de manière troublante à réenvisager le concept technique initial du cinéma, consistant à produire du mouvement à partir d’images fixes. La sensation de vitesse procurée par les images de Tsukamoto enchaînées à un rythme ahurissant me semble bouleversante car elle touche à l’émerveillement le plus primitif dont est capable le cinéma. Pour moi, ce film marque une étape importante et encore indépassée de la conception du montage en termes de dynamique, après Orson Welles et ses plans presque subliminaux, après les premiers Scorcese au début des 70’s , puis les apports du premier « Star Wars », ou ensuite la maximisation de ces effets par Tsui Hark pour son légendaire « Zu ».
Si Tsukamoto n’est pas un cinéaste sans descendance (on peut penser au moins à Jan Kounen et à Darren Aronofsky), aucun de ses disciples ne parvient à susciter les mêmes sensations. Il reste ce cinéaste singulier dont les films se reconnaissent instantanément tout en ne ressemblant à rien de connu.
Je recommande chaudement, vous l’aurez compris. 
Un film cher à mon coeur, qui mêle miraculeusement le malaise instillé par des thématiques lourdes et complexes et un émerveillement plastique d’une grande pureté, le tout pour le budget fraises tagada d’une production Michael Bay. J’ai beaucoup montré ce film, et je profite de l’occasion offerte par Benoît pour reparler avec émotion de cet immense film, qui agace, dégoûte ou fascine, mais ne laisse PERSONNE indemne.