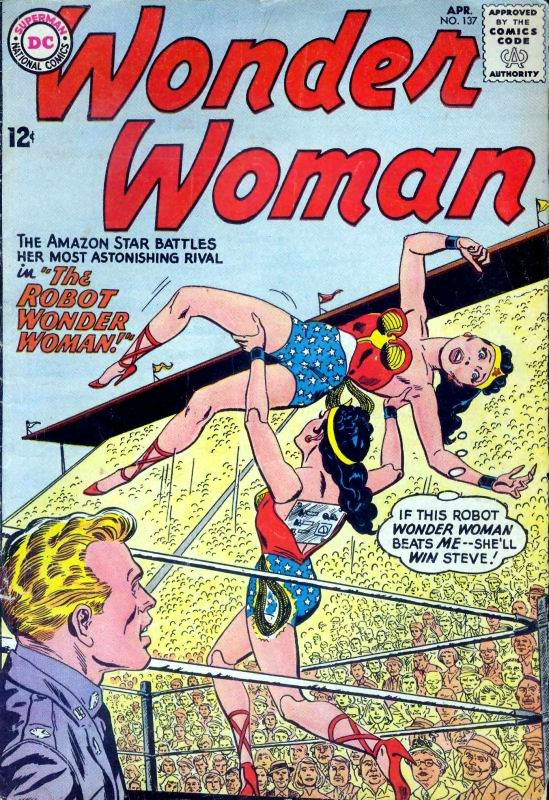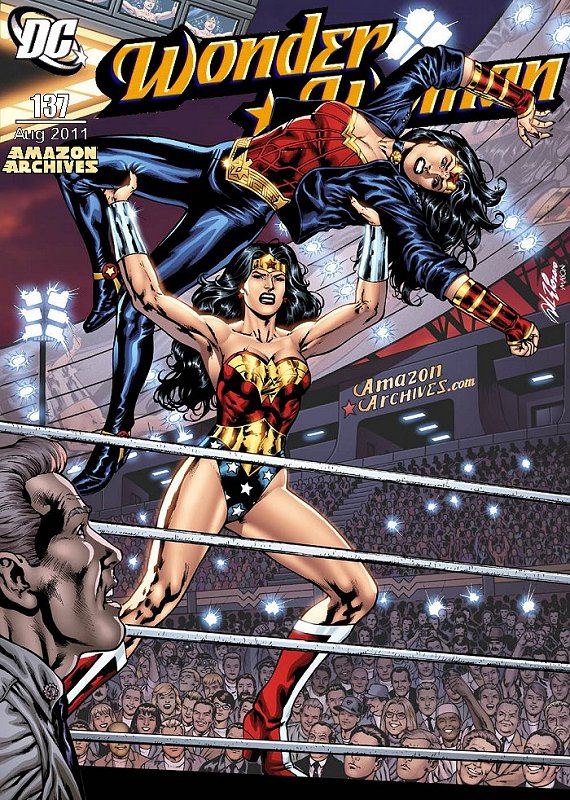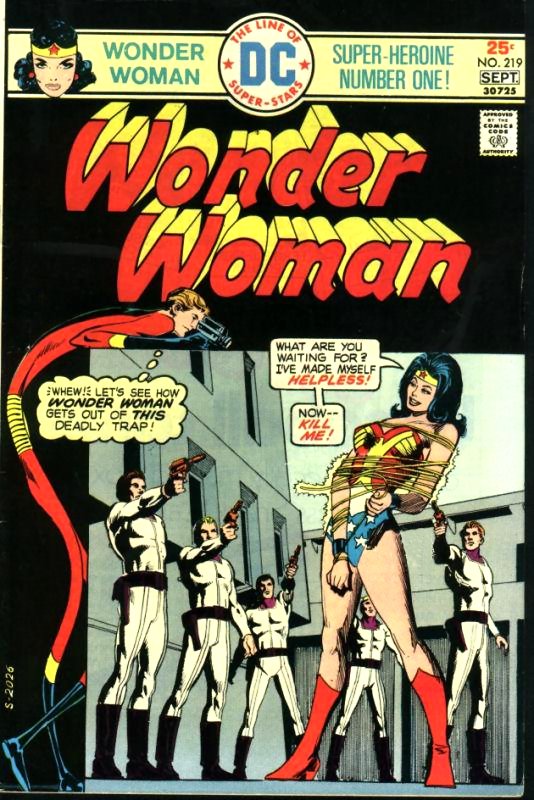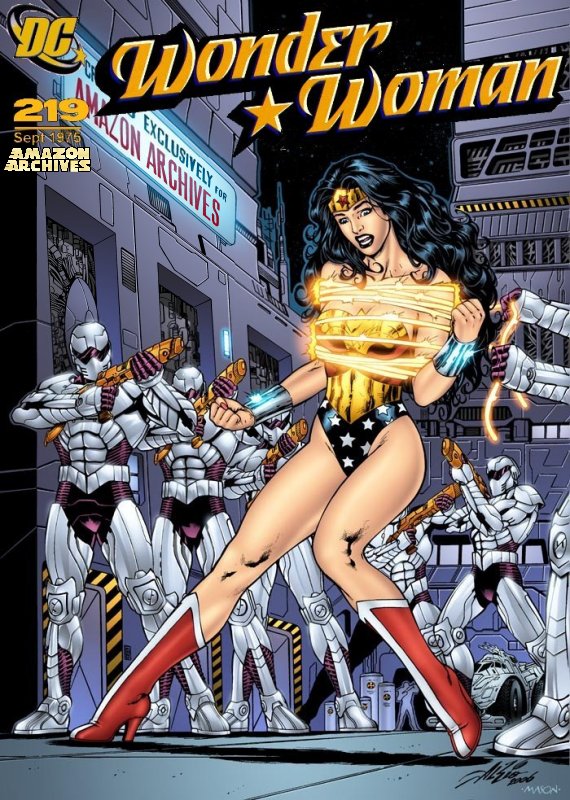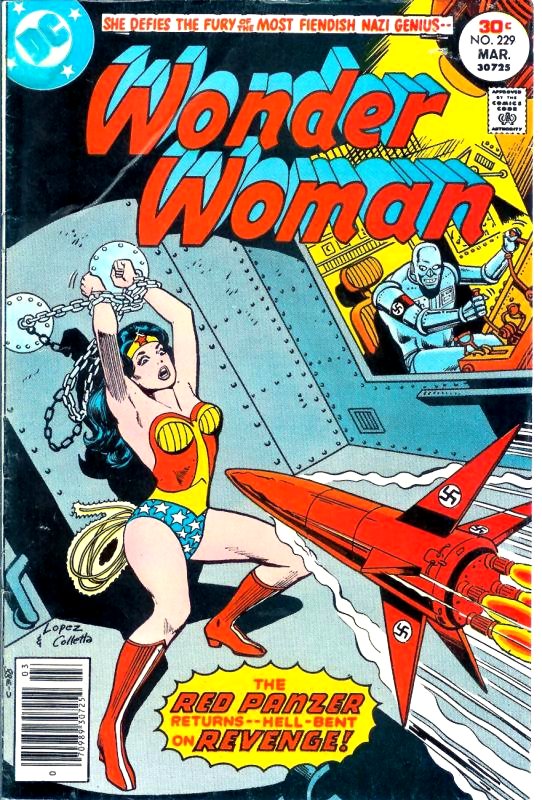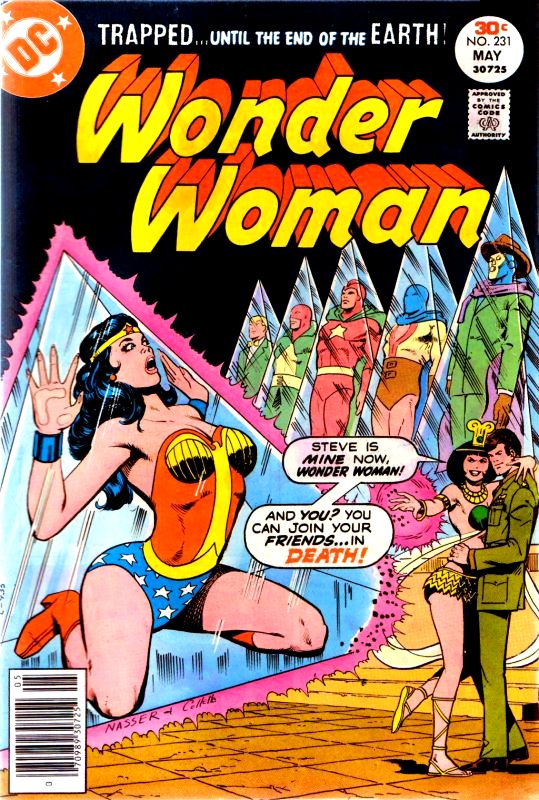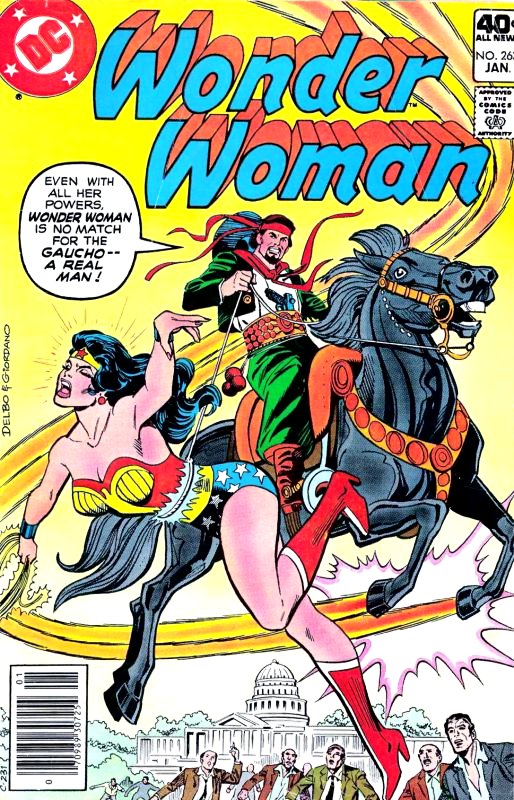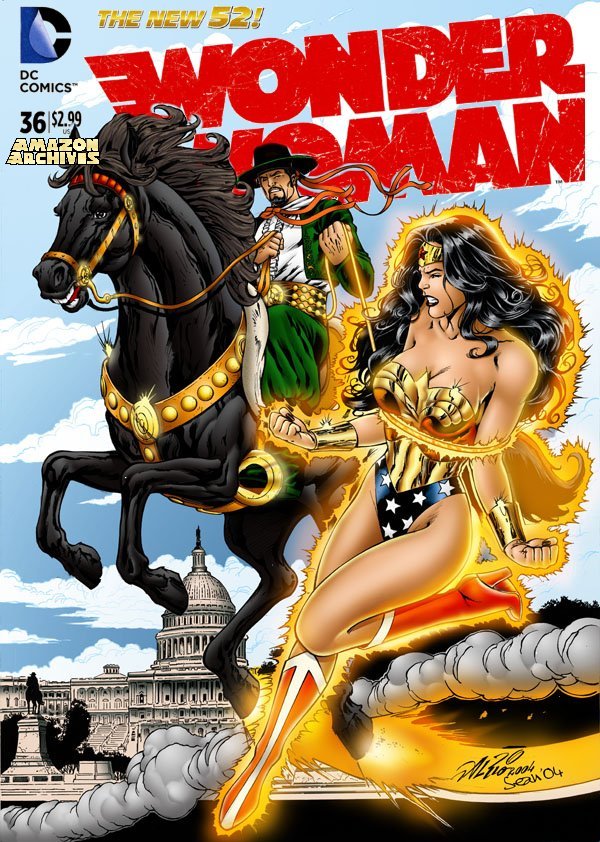Entre le départ de George Pérez et l’arrivée de John Byrne, la série Wonder Woman a été écrite par William Messner-Loebs, un scénariste connu pour son goût du décalage et sa capacité à offrir aux personnages de super-vilains une place de choix, sinon une possibilité de rédemption. L’auteur s’amuse souvent à explorer les frontières entre le bien et le mal, le grandiose et le minuscule, le grotesque et le sublime, ce qui le conduit à mélanger les genres et à proposer une vision différentes des personnages. Sa prestation, jusqu’aux épisodes qui précèdent ceux illustrés par Mike Deodato, a été récemment rééditée en deux tomes par l’éditeur (enfin, récemment : le temps passe vite, ça date quand même d’août 2020 et février 2021, en pleine période de crise sanitaire avant vaccin, on doit être nombreux à ne pas avoir pris attention à l’annonce de ces rééditions).
L’arrivée de Messner-Loebs se déroule dans Wonder Woman Special, qui annonce le changement éditorial. Le procédé s’impose petit à petit chez DC. C’est notamment par le truchement de numéros spéciaux que l’éditeur va promouvoir certains changements d’équipes créatrices sur les titres liés à la Ligue.
Pour l’occasion, le dessin est assuré par Jill Thompson, dont le nom est déjà associé au personnage lors des derniers événements racontés par Pérez. On notera une très belle couverture où le travail de l’illustratrice est encré par Jerry Ordway, une association qui semble profiter aux deux : on y retrouve à la fois l’énergie et l’expressivité de la première et le sens du détail du second.
Le prétexte de l’histoire est simple : la Cheetah a disparu, apparemment enlevée dans un pays de l’ancien bloc soviétique (que ça fait drôle de relire ces épisodes en ce moment), et Diana décide de monter une mission furtive afin de prêter aide à son ennemie. Elle enrôle donc Deathstroke, qui fait des pieds et des mains pour diriger l’opération. Désireuse de passer inaperçue, Diana choisit de changer d’apparence, imitant l’allure et les manières de son amie Mindy, qui a occupé une grande place dans la période Pérez.
Messner-Loebs nous montre également que la Princesse Amazone est en mesure d’entrer en contact avec les êtres mythologiques et de profiter de certaines de leurs faveurs (ici : le changement d’apparence, le déguisement, l’illusion). Ces contacts mystiques reviendront plus tard dans la série.
L’intrigue se conclut dans le numéro 63, daté de juin 1992, qui marque l’arrivée du scénariste mais aussi de Brian Bolland au poste d’illustrateur de couverture. Diana, capturé par ses ennemis, est offerte en sacrifice à une déesse un brin lovecraftienne provenant d’une autre dimension. Là encore, Messner-Loebs pose une autre constante de sa prestation, à savoir l’utilisation de la magie par des humains.
Ayant reposé les fondamentaux de l’héroïne (elle ne tue pas, elle aide, elle incarne l’espoir), le scénariste et la dessinatrice livrent ensuite un nouvel épisode où Diana enquête sur l’enlèvement d’une enfant. Le chapitre est écrit de manière à alterner les actions de l’Amazone et celles de l’inspecteur Indelicato (déjà présent dans la période Pérez).
Ce premier recueil ne reprend pas l’épisode 65, écrit par Joey Cavalieri et dessiné par Paris Cullins, mais propose à la place l’Annual 3. Ce récit est orné d’une très chouette couverture de Joe Quesada, et s’inscrit dans la saga « Eclipso Within », dont DC n’a pas encore eu la bonne idée de publier l’intégrale, alors que ça me rend très curieux. Hélas, son inscription dans le sommaire se fait au chausse-pied, l’épisode n’étant pas accompagné d’un petit texte de présentation ni d’un résumé, les notes de bas de case étant même effacées et laissant des pavés de couleur vides. Dommage.
Car, en effet, le récit tombe comme un cheveu sur la soupe et rompt la logique du recueil. Et pourtant, on devine bien l’importance de ce chapitre. En effet, on y rencontre le White Magician, un sorcier qui officie visiblement depuis les années 1940 sous différents noms, et qui utilise sa maîtresse, une journaliste, afin de se tailler une réputation médiatique. Provoquant la possession de Wonder Woman par Eclipso, il perd le contrôle de l’Amazone. Et l’épisode se finit là. Sans explication, puisque la suite figure dans le cross-over.
Sans ménagement, le sommaire passe donc à Wonder Woman #66, début de la première saga d’ampleur signée Messner-Loebs, une aventure assez inhabituelle pour l’héroïne, à qui il est demandé d’aller sauver une cosmonaute russe en perdition. Sauf que, bien entendu, il y a un piège, et le satellite où elles se retrouvent connaît une avarie qui les projette loin, très loin dans la galaxie.
L’autre gros problème éditorial, c’est que le commanditaire, c’est Thomas Asquith Randolph, dont on sait qu’il s’agit du White Magician. Pourquoi donc Diana ne se souvient-elle pas de lui ? Est-ce expliqué dans le cross-over « Eclipso Within » ? En tout cas, ce n’est pas éclairé dans le recueil, ce qui rend la lecture plus circonspecte encore.
La saga spatiale de Messner-Loebs est illustré par Paris Cullins, qui signe un travail assez comparable à celui de Tom Morgan : musclé, tourné vers l’action, expressif mais sans fioriture. Les deux femmes, dans un vaisseau sans repère, sont capturées par une race d’esclavagistes qui les font travailler dans des mines. Le scénariste décrit une héroïne qui ne perd jamais espoir, mais qui affiche un tempérament bien badass. À la fin de ce deuxième chapitre, elle explique à sa camarade cosmonaute que les esclavagistes ont fait une erreur :
La saga dure cinq épisodes. Cullins dessine une Wonder Woman (sans costume, première variante quand celle-ci devient capitaine d’un équipage féminin de pirates, dont Bolland donne une version bleu foncé et jaune qui n’est pas sans rappeler la tenue des Judges) parfois un peu hommage mais toujours charismatique.
Finalement, Wonder Woman parvient à libérer ses co-détenues, toutes des femmes venues des différentes races de l’univers DC, renverse le pouvoir et découvre les dessous de cette race, qui change de sexe tous les cents ans et vit selon les règles d’une guerre des sexes perpétuelles, le sexe dominant de leur race réduisant en esclavage l’autre sexe des races qu’ils rencontrent.
De retour à la fin du numéro 70, Wonder Woman découvre que Themyscira a disparu. C’est aussi le moment où le dessinateur Lee Moder arrive sur la série. Son dessin, qui évolue vite, évoque un Alan Davis débutant, et lorgne aussi vers Kevin Maguire ou Paul Smith. C’est assez joli, élégant, expressif.
Diana renoue avec Steve Trevor, qui monte sa propre petite compagnie aérienne, et Etta Candy, qui l’accompagne dans l’aventure. Elle croise aussi de nouveaux personnages, dont une fliquette au caractère trempée (dont elle sauve la vie en recourant une fois de plus à une aide mythologique) et un détective privé de bas étage. La présence du White Magician se fait à nouveau sentir, mais Diana a d’autres priorités : trouver un boulot (elle devient serveuse dans un fast-food) et en apprendre davantage sur la disparition de son île.
C’est donc dans Wonder Woman #76 qu’elle est projetée dans le passé récent, et découvre que la disparition (et apparemment la mort) des Amazones est liée à Circé. Grâce à Doctor Fate (qui, à l’époque, est Inza Nelson), elle découvre que cette dernière est morte également.
C’est sur cette impasse que se conclut ce premier recueil. La lecture de ces épisodes méconnus, écrasés entre deux périodes marquantes, est très agréable mais les points faibles de Messner-Loebs deviennent évidents. Certains personnages (secondaires, certes) changent de nom : la fille de la cosmonaute passe d’Aleks à Mischka, le chaton de Vanessa est d’abord nommé Archimedes avant de devenir Aristotle, et on se demande ce que fait l’équipe éditoriale. De même, le scénariste présente un grand nombre de personnages qu’il ne nomme qu’à la scène suivante, voire dans l’épisode suivant. Cela peut parfois rendre plus confuses que nécessaire des histoires d’abord assez simples.